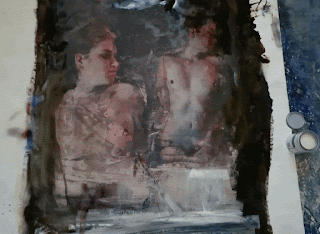Jeter le bébé avec l’(e) (Vers)eau du bain… ?
La crise du Coronavirus n’est-elle pas l’occasion rêvée de
repenser lentement le monde ?
Opéra catastrophe
Le confinement est une période de flottement, de "non-temps", idéale pour se reposer et jeter un coup d'oeil dans le retroviseur de l'histoire du monde, et en particulier sur les deux dernières décennies, qui furent aussi celles du début du 21 siècle.
Difficile, aujourd’hui, en
2020, de ne pas considérer ces vingt dernières années, comme celles des plus grands changements qu’ait jamais
connu l’humanité, sur tous les plans et dans toutes les catégories de pensée et
d’action, dans une sorte d'immense accélération.
La destruction en 2001 des Twin
Towers en fut le signal déclencheur, telle l’ouverture tragique d’un opéra
catastrophe, avec pour corollaire et suites la remise en cause active du modèle
capitaliste et de l’impérialisme américain, sur fond d’intégrisme musulman, créant
l’irruption d’un terrorisme islamiste aveugle, partout dans le monde.
Cette vague de déstabilisation a
ébranlé toute la planète, avec une profonde déstabilisation du Moyen Orient, la
poursuite des guerres pétro-politiques dans le Golfe entamées dans les années
90, la guerre en Syrie contre un dictateur aveugle et sanglant, l’émergence de
Daesh pris de rêves de califat, la chute des régimes autocratiques nord
africains et les Printemps arabes consécutifs, morts-nés au profit d’une
radicalisation politico-religieuse islamiste.
Les crises migratoires ont encore
davantage créé le sentiment de déstabilisation, en provenance des zones de
guerre moyennes orientales ou de l’Afrique subsaharienne, annonçant de bien
pires migrations à venir, génératrices de drames humains dans le bassin
méditerranéen, que ni le barrage turc acheté à prix d’or et qui cède
aujourd’hui, ni les frontières militaro-sécuritaires ne pourront bientôt plus
contenir.
Les relations entre la Chine et
les Etats Unis, se sont largement détériorées, surtout depuis l’avènement au
pouvoir de Donald Trump, transformant les échanges économiques entre les deux
premières puissances économiques du monde en gigantesque ring de boxe, tandis
que la Russie joue le rôle d’arbitre vendu, entre la Syrie et la coalition
occidentale, et que le monde assiste, impuissant, à la dérive autoritaire
fanatique de la Turquie définitivement laissée à la porte de l'Europe. Israël s’enferre dans sa politique coloniale des
Territoires palestiniens, tandis que face à cet immense shaker détonant, l’ONU semble être
le balcon feutré auquel s’accrochent, en plein désespoir, des diplomates cravatés
par leurs gouvernements respectifs.
Un monde nauséabond, sous
l’œil omniscient d’Internet
A ces bouleversements de type
politico-religieux s’est ajouté l’œil omniscient de l’Internet qui rend compte
en temps réel de la déréliction du modèle d’avant, charriant dans son égout les
pires boues de l’humanité, rendant plus nauséabonde encore l’actualité, à coup
de fake news, de posts vengeurs, voyeurs ou vomitifs. En
parallèle, apparaît salvatrice la posture et le statut des lanceurs d’alerte,
choisissant Internet pour faire savoir au monde entier ce que certains voudraient cacher…
Dans ce contexte, la dérégulation
complète du climat, parfaitement perceptible sous toutes les latitudes, met
sous les yeux médusés de l’humanité les conséquences ravageuses d’un mode de
consommation irresponsable et tout-puissant, mettant en cause la survie même de l'espère humaine sur terre, à la suite d'une chute brutale de la diversité . Ce changement climatique a poussé
les étudiants de tous les horizons occidentaux dans les rues, contestant les
politiques publiques attentistes et inefficaces, prenant le pouvoir en
abandonnant l’école, et se choisissant pour porte-parole une adolescente
aux allures christiques.
La crise financière de 2008 a
démasqué le capitalisme le plus débridé, montrant le faciès hideux de ses
pratiques les plus immorales, financiarisant des dettes et combinant en toute
impunité l’épargne en de complexes produits financiers toxiques, entraînant
dans une chute vertigineuse l’économie mondiale, obligeant les états et les
régulateurs centraux à voler au secours des banques par l'injection massive de liquidités, fragilisant, ce faisant, les
populations les plus précarisées par un taux d’endettement abyssal et une situation
macro-économique vacillante.
L’Europe, qui fut depuis la fin
de la Seconde Guerre Mondiale le plus grand idéal politique jamais promu par
des ennemis autrefois irréductibles, a produit, à l’échelle continentale, la
plus longue ère de paix qu’ait jamais connu l’humanité sur une aussi grande
partie du monde. Ces dernières décennies, l’Europe a hélas fini de démontrer
son inefficacité à répondre aux vrais enjeux de société, aux réels problèmes de
ses citoyens, en raison de son indéfinition essentiellement culturelle, de son
mode de fonctionnement intrinsèque à l’unanimité et de sa technocratie aussi
coûteuse qu’inopérante. Cette critique conduit désormais à une sortie en
cascade, attendue ou avérée, de tous les eurosceptiques, la Grande Bretagne en
tête.
Le Pays des Droits de l’Homme est
devenu le théâtre de la contestation, sous toutes ses facettes, « gillet-jaunisant »
les villes et les campagnes, clivant la société en factions opposées,
entraînant destructions, grèves et prises d’otages sur tous les fronts de
l’action politique et syndicale. Bloquant le pays économiquement et l’emmenant
au bord de la rupture par le tenue de grèves interminables, le peuple 'cette partie de la société sur laquelle s'exerce le pouvoir' dit Michel Onfray, tente de
résister aux réformes, telle celle des retraites, menaçant les
acquis des Trente Glorieuses en raison d’un réalisme politique lié aux
incertitudes économiques et à l’inversement de la pyramide démographique.
Les gouvernements et parlements
des démocraties occidentales moribondes sont obèses de créatures politiques
pléthoriques, plus inquiètes de leur réélection que de leur rôle premier de
représentation, produisant une inflation accélérée de textes législatifs, notamment
dans le domaine de l’éthique, autour de la mort, de la procréation, du mariage
pour tous, ou dans les domaines du progrès social, autour des retraites, des
congés parentaux après la perte d’un enfant,… autant de débats opposant les
citoyens, favorisant les oppositions et fertilisant les luttes haineuses.
Les grands systèmes numériques
tenus par les GAFA’s américains monopolistiques (reléguant l’Europe à la traîne
de son exploitation) moissonnent massivement nos données personnelles, ce
nouvel « or noir » de l’économie, attendant l’instant proche où elles
seront disponibles et indispensables à un contrôle total de nos libertés individuelles, dans un croisement programmé de l’infotech (la
5G !) et du biotech, détruisant par la même occasion le tissu social et
associatif, le commerce de proximité, la poste, l’intimité et la saveur
relationnelle, les métiers de la pensée et de la création (libraires,
écrivains, artistes, etc…), virtualisant tout, sans exception, au cœur de data
centers déshumanisés.
La mort de l’esprit de nuance
Certains médias poursuivent
leur travail de sape par une désinformation rampante, sous le contrôle de
grands groupes détenus par des fortunes personnelles assoiffées de
reconnaissance et de pouvoir. Dans ce contexte, sous l’influence des réseaux, les
masses adhèrent à des idées simplistes et répondent aux populismes de tout poil, lesquels écrasent
les démocraties sous le talon des instincts primaires de racisme
et de communautarisme, conduisant la société en rang serré vers de nouveaux
univers concentrationnaires, numériques notamment.
Cette désinformation massive
encouragée par les médias dits « sociaux » polarise la société en
‘pour’ et ‘contre’, sans la moindre finesse, désignant implicitement et
corrélativement sa véritable victime : l’esprit de nuance. Il est ainsi
déplorable qu’à proportion de la toute-puissance de cette désinformation se
trouve inversement dérisoire le rôle de l’intellectuel, condamné au silence
imposé au grincheux et au moralisateur, dès qu’il tente de raffiner le
jugement, de contextualiser les faits, de nuancer les postures, de les relier à
l’histoire, à la philosophie ou à l’art. Disqualifiant la pensée, notre monde
de médias a choisi de préférer la satisfaction du lynchage immédiat à toute forme
de recul moral ou spirituel qui permettrait de comprendre avant de juger.
Dans cette entreprise
d’aliénation, les religions – et singulièrement l’Islam - accentuent leurs emprises sur les esprits les
plus faibles et déculturés par la possibilité de mieux contenir les individualités
et d’en radicaliser le comportement, par une pratique répondant de
l’orthopraxie pure, notamment par le port de signes distinctifs vestimentaires –
exclusivement féminins - discriminants et archaïques, reléguant tout idéal
d’égalité et de laïcité républicaine au rang des vieilles valeurs, aujourd’hui suspectes
d’islamophobie.
La lutte intersectionnelle, un
danger de totalitarisme ?
La faillite du communisme dans
les années 90, laissant vainqueur un néo-capitalisme mondialisé, plus immoral
que jamais, a nécessité que soit modifiée la lutte des classes en lutte de genres, au sens large :
les damnés de la terre d’hier, le prolétariat, les ouvriers dépossédés de
l’outil de production au profit du capital, ont été interchangés au profit de
tous les discriminés d’aujourd’hui, les nouveaux prolétaires, les proscrits,
les sans-places : les musulmans, les noirs, les femmes, les homosexuels et
toute la mouvance lgbt, les sdf, les migrants, les minorités de toutes natures,
les zadistes, les marcheurs pour le climat, etc... Nous sommes arrivés au point
culminant de la démocratie dictée par les lobbies de toute espèce. Seule cette
démocratie-là a encore une place dans les vrais débats de société… même si nous sommes les premiers à considérer qu'ils y ont leur place !
D’une lutte des classes
horizontale découlant du matérialisme dialectique historique marxiste,
distinguant ceux d’en-haut de ceux d’en-bas, cette nouvelle lutte des genres
est désormais verticale, divisant la société par colonnes, par segments, sans
considération de milieu social ou d’horizon économique. Cette lutte d’un type
nouveau embras(s)e toute la société : marquée au sceau de la
stigmatisation expéditive, elle trouve dans la lutte antidiscriminatoire,
intersectionnelle, une forme de prêt-à-penser confinant à un Salut moderne, menacée
de dérive totalitaire, prononçant l’excommunication à l’envi et frappant
d’anathème toute forme d’opposition, convaincue d’être du bon côté, créant
parfois, dans le bain unanime de la bien-pensance, de grandes injustices, et générant des schismes douloureux au sein de la
société (pour mémoire, la haine qui a divisé les pro ou contra "mariage pour tous" ou la GPA).
« Jeter le bébé avec l’eau du bain »
Dans cet ‘unanimisme’ inflexible,
s’expriment les tenants les plus dogmatiques de chaque pensée, discréditant tout
discours divergent par un procès d’appartenance : si vous réclamez un peu
de nuance sur le climat, on vous taxera de capitaliste pollueur inconscient, si
vous jugez nécessaire un débat sur le port du voile et sur la possible
intégration islamique au modèle occidental de laïcité, on vous collera
l’étiquette d’islamophobe, si vous demandez une légère prise de distance par
rapport à la délation corolaire aux mouvements #balance ton porc ou #metoo,
on vous mettra en accusation pour misogynie et machisme, faisant le procès de
vos arrière-pensées, et l’on prétendra que c’est votre crainte de voir vaciller
le patriarcat blanc industriel chrétien qui génère en vous toutes ces
interrogations.
Réhabilitons le masculin par un
féminisme nouveau, non celui de nos mères et de nos grand-mères qui réclamaient
l’égalité… Car on ne peut que perdre au jeu de l’égalité lorsque les règles du
jeux sont dictées par l’autre… Le féminisme historique a tout perdu sur ce terrain.
Remettre le féminisme sur les rails des préoccupations de la société contemporaine,
c’est avant tout définir et redéfinir la place de l’homme, en regard de celle
de la femme, et inversement ! Un féminisme qui serait d’abord celui de l’affirmation
des différences entre les genres, pour mieux les réduire. Un féminisme qui
verrait la complémentarité avant l’égalité entre les sexes, rééduquant l'homme, dès la petite enfance, dans son rapport à la femme. Un féminisme qui
requalifierait et recalculerait le statut de la maternité en fonction de son
rôle et de son apport à la société permettrait à l'enfantement de ne plus se faire sur le dos de l'épanouissement féminin, grâce à des structures et des moyens adaptés. L'autel sacrificiel sur lequel se sentent, souvent à raison, pour ne pas dire toujours, immolées les mères de nos société contemporaines est également celui du couple et de la famille… Le temps est venu de trouver une véritable réponse sociétale à cette question de l'enfantement chez la femme.
Des changements, et un
nécessaire arrêt. Le Coronavirus en frein providentiel ? La fondamentale
question de l’inutilité.
Bref, on le voit, ces changements
se sont accélérés avec une vitesse sidérante, produisant en moins de vingt ans
une société radicalement différente de celle qui avait vu s’achever le 20ème
siècle.
Dans cet immense bouleversement,
où chercher les réponses face aux milliers d’hypothèques et de questions qui
pèsent sur l’avenir ? Notre recours ultime serait-il de nous tourner vers
les astrologues qui nous disent que, suivant les prédictions aztèques du 15è
siècle, nous sommes entrés dans l’Ere du Verseau depuis 2012 ? Cette ère
suit celle des Poissons. Avec le Verseau tout verse, tout se renverse, tout
coule, tout croule, c’est une ère liquide, aqueuse, éminemment l'ère du
changement.
Si donc cette ère a bel et bien
débuté, nous ne pouvons pas douter un instant de sa réalité ! En effet,
tout bouge, tout change, tout mute, tout se modifie…
Mais si cette vingtaine d’années
écoulée avait commencé par l’ouverture tragique du spectacle désolant de l’effondrement
des Twin Towers, métaphore prophétique de l’écroulement du monde d’avant,
voici que l’irruption foudroyante du Coronavirus semble sonner comme la clôture
effroyable de cet opéra tragique, condamnant l’humanité à un confinement
généralisé, renvoyant les plus positivistes à des peurs moyenâgeuses, réorganisant
les perspectives et les priorités suivant une hiérarchie de valeurs dominée par
le prix de la vie individuelle, et condamnant les économies du monde entier à
la récession, dans un mouvement collectif, quasi hypnotique, d'immolation des libertés individuelles.
Ce virus inconnu semble donc accompagner et clore cette période
de mutation profonde des vingt dernières années, pour ouvrir sur une voie
nouvelle, un monde d’après.
Cette crise sanitaire nous appelle
à l’humilité, et nous confronte aux limites de notre hubris, de notre
orgueil démesuré qui agite le monde depuis des décennies, précipitant
l’humanité dans une fuite accélérée vers le néant matérialiste et technologique.
Elle nous renvoie aux valeurs premières de nos vies et de nos familiales
intimités ; nous sommes désormais assignés à résidence, cherchant à
trouver dans le singulier colloque intérieur de nos habitations la source de
bonheurs simples et d’occupations commensales… Notre projet de vie redevient
subitement domestique, familial et statique, raisonnable et mesuré, artistique,
gratuit et contemplatif, prévoyant et solidaire.
Voilà qui semble ponctuer cette
ère de révolutions par une profonde remise en question que nous impose cette véritable pause
ontologique. Ce moment de réflexion, rigoureux comme une cure, nous ne nous
invite-t-il pas à raisonner nos vies et nos choix, en vue d’un changement né de ces
douloureuses expériences ?
En définitive, ce que cette crise
sanitaire convoque, c’est la question fondamentale de l’inutilité… Plus
encore que la consommation obscène et la gabegie de biens et de services inutiles,
rendus accessibles à des proportions exponentielles par Internet, se pose la
question de la production de ces 'consommables', elle-même.
A la suite du philosophe et sociologue français Bruno Latour, posons-nous la question de savoir si le monde ne pourrait pas, en définitive, se passer de ce qu’il
produit dans une débauche de moyens mondialisés, à grands renforts de création
de besoins, de publicité et de laideur, passant ainsi les plats d’un capitalisme
débridé, et exploitant toujours plus, telle une rente post-coloniale sans
limite, une population précaire à l’autre bout du monde, sous-payant ces
nouveaux esclaves, exploitant leur super-dépendance, et recyclant, sous couvert
de développement, la misère en main d’œuvre ?
Ce que ce coronavirus montre, c’est
notre totale dépendance, désormais, à ces moyens et lieux de production délocalisés
et mondialisés, lorsqu’un phénomène systémique de frein brutal vient en bloquer
les rouages. En quelques semaines, on assiste à un coma organisé et à un
délitement subi(t) mais sans doute durable des chaînes d'approvisionnement.
La fragmentation de la
mondialisation qu'immanquablement cette crise provoquera, constitue une
occasion inespérée de reprendre les commandes.
"Arrêtons de dénoncer, commençons à énoncer", dit Edgard Morin:
- relocaliser les productions
vitales de notre économie,
- réguler les échanges et les investissements par des
organismes et des mécanismes publics de contrôles et de prévention,
- prélever
fiscalement les géants de l’Internet, échappant jusqu'ici à toute redistribution car étant, par définition, non localisés,
- taxer lourdement l’inutilité, sous toutes formes, dont le trafic aérien low cost,
- encourager l’économie durable, solidaire, locale et juste, et dans les pays
émergents,
- pratiquer une tarification de la main d’œuvre qui soit digne,
- relancer, dès les classes maternelles et jusqu’à la fin du cursus scolaire l’éducation
artistique, civique et naturelle,
- réinvestir les campagnes et délaisser les
villes,
- revaloriser l’artisanat et les métiers d’art – tout ce qui fait
travailler la main,
- instaurer un service civil obligatoire, à destination de
tous les jeunes, etc…
La liste est longue des nouveaux chantiers à ouvrir, la
carrière de notre "jour d’après" étant longue et fertile !
Notre intime conviction serait cependant,
et en tous cas, de ne pas nous précipiter. Il ne faudrait pas en effet jeter le
bébé avec l’eau du bain, dans cette grande vague projetée par le Verseau sur le
monde !
Surtout, évitons de rendre permanentes et communément admises les
mesures temporaires, notamment liberticides et anti-démocratiques, que nous
impose ce virus !
Le temps long, l’esprit de
nuance et les vertus de l’enfance
Privilégions le temps long, alors
qu’il semble s’accélérer toujours plus… Cette crise sanitaire nous y invite,
par son obligatoire changement de rapport à la temporalité, alors que des
semaines de confinement nous placent dans une durée infinie, sans repères…
Pour y parvenir, abandonnons le
matérialisme historique au profit d’une nouvelle façon d’être-au-monde et d’une
véritable écologie de l’esprit. Favorisons la finesse d’analyse et le retour de
l’esprit de nuance, interrogeons nos bonnes intentions et nos mauvaises
habitudes, vivons nos vies à la lumière (ou à l’ombre projetée) de la mort et
de la maladie, donnons la parole à celles et ceux auxquelles elle a été trop
longtemps confisquée, principalement les intellectuels, les vrais artistes, les
spirituels et les sensibles. Laissons les colères de côté, abandonnons les
luttes violentes, les posture stigmatisantes et les marches bruyantes.
Voyons comment créer l’harmonie
entre les genres, entre les êtres, entre les pensées, recentrant le débat sur
le modèle sociétal qui a, depuis le début de l’humanité, fondé son progrès et
garanti sa civilisation : la famille. Oui, la famille, au sens large et symbolique même, sans atteindre
immédiatement le Point Godwin, par la fallacieuse et fachiste apostrophe ‘Travail-Famille-Patrie’
qui a nuit énormément à cette valeur première.
Habiter le monde en poète, vivre
en artiste, et entrer dans la déflation lente, avec la conviction que, si le
changement est certes nécessaire en bien des points de l’écheveau social,
économique, politique, spirituel et moral, l’Humanité a mis des centaines de
milliers d’années à se construire telle qu’en elle-même… Peut-être convient-il
donc de bien réfléchir aux conséquences de nos aspirations révolutionnaires… et en particulier de
nos modes de production et de consommation.
Restons les dignes héritiers des
Enfants de l’Humanité… C’est d’ailleurs de l’enfance qui viennent les plus
élémentaires leçons de changement. Chez l'Enfant, sa spiritualité pure, son goût simple, sa
joie naturelle, son équilibre premier, son imagination sans borne et sa douce
naïveté, ... sont autant de sources d’inspiration utiles à la conception d’un nouveau
monde.
Car il ne faudrait donc pas qu’en
quelques décennies, dans une forme d’accélération mortifère, l’Humanité cherche
à se sauver au détriment de ce qui fait l'Humanité ! Ce virus n’en viendra pas à bout, mais il donne l’occasion de
prendre une leçon, de repenser le monde, en faveur d'une plus grande écologie de l'esprit et du coeur.
.png)