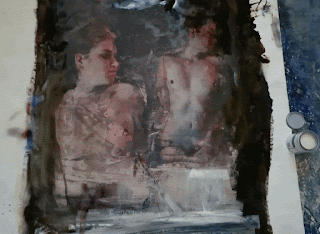« J’ai lu l’ineffable
palimpseste.
Un instant, je m’y suis retrouvé,
Puis, soudainement, d’un seul geste,
Tout était effacé. »
Ce texte accompagne le catalogue de l'exposition monographique organisée par la Ville de Mons à partir de septembre 2023 consacrée à l'œuvre de l'artiste Didier Mahieu (1961) au Memorial Museum de Mons
Entrer dans la peinture de Didier Mahieu, c’est opérer une
descente dans les tréfonds de l’infiniment mince, se livrer à l’exploration
discrète d’une géologie spatio-temporelle qui structure sa matière par strates,
par époques, et qui se lit pourtant sans apparente direction.
C’est aussi une plongée dans les nimbes opalescents du soi,
cette région de notre anatomie mentale, tout à la fois lumineuse et opaque, illisible
sous les calques de nos peurs et de nos certitudes.
C’est enfin une invitation à l’assoupissement du moi,
confiant au regard du cœur la nécessaire dépossession des jalons qui rassurent,
congédiant les impatiences à comprendre, libérant des inquiétudes du destin, et
renvoyant dos à dos raison et logique.
La pratique de cet artiste polymorphe est toujours dictée par
un souci aigu de ne rien enfermer, de ne pas contraindre, cherchant d’abord
l’émotion à travers une « ineffable narration », curieux oxymore –
raconter ce qui ne peut se dire - puisqu’à mesure que, sur la toile, le papier,
l’écran, se développe le récit, s’en retire le sens. Tenter de dire la chose,
chez notre artiste, c’est paradoxalement la laisser se dissoudre, l’inviter à disparaître,
fondue par la touche du pinceau dans le lait du souvenir. Serait-ce là
l’essence-même de sa peinture que de métaboliser la réalité, pas seulement
figurative, en en transmutant la nature au profit d’une nouvelle vocation à
exister : la modification du réel en un substrat vaporeux, plus lisible de
son irréductible complexité ? Cette transmutation de la « matière
réel » en un éther impalpable, voilà l’alchimie à laquelle se livre notre
peintre. C’est après l’évaporation du réel sous son pinceau que peut se définir
sa substance, comme dans les boîtes à papillons dont ont disparu les sujets
rongés par d’autres insectes, et dont la pulvérulente ombre permet d’en mieux cerner
le souvenir. Cette peinture convoque donc immanquablement la perte, la
disparition, le glissement, qui sont autant de formes d’un reconditionnement du
réel par sa propre mise en joue, par sa vaporisation, pour en mieux
reconstituer l’essence.
Il émane donc de l’œuvre de Didier Mahieu un état de
conscience indéfini, une forme de poétique peinte qui dit un sentiment trop
grand pour être décrit de façon adéquate, qui ne peut donc pas être
intrinsèquement exprimé dans un langage pictural univoque, mais auquel le sujet
regardant ne peut avoir accès qu’à partir de lui-même, pour mieux se raconter. C’est
dans cet appel à l’autre, ce souhait sincère de toucher, que s’inscrit la
démarche du peintre, engendrant entre l’artiste et son public un lien complice
et intime : le spectateur entre dans l’œuvre, comme on entre en relation,
c’est-à-dire par une initiation du regard qui conduit à la compréhension
individualisée du tableau. Chacun y trouve ce qu’il y cherche, ce qu’il croit y
reconnaître, à commencer par lui-même. Dans ce rapport altruiste par lequel
l’artiste ouvre les bras à celui auquel il destine sa peinture, Didier Mahieu
procède à la réparation de nos blessures, à l’éveil de nos consciences, à
l’interrogation de nos souvenirs. Il se saisit de nos rêves, irrévocablement
voués à la perte et à l’oubli, et nous les restitue dans cette indéfinissable
acuité du songe qui cohabite aussi avec l’informe.
Dans ce voyage paradoxal entre le fini et l’indéfini se
révèle toute la pratique picturale du peintre, conjuguant une parfaite maîtrise
du dessin et de la peinture figurative avec l’expression spontanée et libre
d’une abstraction lyrique assumée. Procédant par couches successives, tel un
laqueur japonais, le peintre efface et revient à la surface picturale,
frénétique va-et-vient entre le signifiant et le signifié. Ces tableaux sont
comme les tablettes de cire de l’antiquité, sans cesse réécrits, effacés,
raturés, véritables palimpsestes de notre humanité. La patine du temps, le
retour incessant à une expression peinte qui ne veut jamais s’interrompre, la
polysémie du récit, voire sa disparition, conduit à une forme de ritualisation,
de sacralisation même de ces ‘objets peints’, désormais chargés d’une énergie
maximale, enrichis d’une intention qui est aussi une prière, et qui leur
confère un statut d’icônes. Leur préciosité tient davantage à la
condensation des émotions qu’à leur réalité formelle.
DiMu détourne des supports anciens pour densifier davantage
son dessin ou sa peinture, cherchant à communiquer ce trouble né d’une trame
brutale, inappropriée, qui tranche avec le sujet, onirique, subtil. En
sous-jacence, la superposition des images et parfois des mots renforcent la
compréhension que l’on croit avoir de la complexité. En réalité, cette lecture
à plusieurs entrées n’en fait qu’épaissir le mystère.
Mais que disent ces visages mutiques, ces personnes qui
tournent le dos, ces yeux et ces bouches fermés, pourtant si présents ? Que
prophétisent ces lointains bleutés, ces marines terrestres de grand format dont
la promesse d’un ailleurs semble ne pas pouvoir être tenue ? Que
chuchotent ces natures mortes métaphysiques, sous la lumière franche de leur
évidence, qui paraissent vouées au silence ?
Cette peinture nous raconte l’impossibilité de réellement
comprendre le monde tel qu’il est, l’incommunicabilité des sentiments, la dissipation
du souvenir tant aimé, la nostalgie d’un autrefois arcadien, l’estompement des convictions
fossiles, en un mot, elle touche à l’universelle finitude humaine, sa misère,
sa difficulté à être, sa paradoxale nature, spirituelle et matérielle. Notre
humanité peine à se définir, souffre de son implacable destin, se débat dans
ses contradictions et pourtant, elle se glorifie de sa prométhéenne capacité à
égaler Dieu.
Partagée entre deux expressions, figurative et abstraite, la
peinture de Didier Mahieu endosse cette dualité. Cette part divine se niche
dans la pratique figurative, qui donne à voir la création comme elle est, en
vérité, dans sa platonicienne triade du vrai, du bien et du beau, là où la
pratique abstraite, lyrique, magmatique et spontanée, renvoie à la saturnienne
nature de l’humanité, contingentée par un temps destructeur qui conduit tout au
néant, tandis qu’elle est figée, les pieds dans la fange terrestre. La
confrontation des pratiques picturales, les meurtrissures apportées à l’image,
les outrages imposés aux matières, les salissures et les effacements
directement portés sur de parfaites descriptions, la récupération de rebus
portés au rang de supports,… sont autant de métaphores de l’existence humaine,
en ce qu’elle est imparfaite, inconstante, souffrante, désillusionnée.
C’est de tout cela dont se saisit la peinture de Didier
Mahieu.
Ces images agissent en nous comme des philtres, lentement,
sourdement, elles nous transforment aussi, embarquant dans leur contenu ce qui
nous y investissons. Le voyage sur la Barque de Charon fait aussi partie de
cette intention de l’artiste de nous amener sur une autre rive, celle du
possible, du promis, du permanent. Mais de ce voyage, de ce transfert vers un
ailleurs, nous ne sortons pas modifiés. Nous en avons perçu la possibilité et
en revenons avec la fulgurante impression que nous ne sommes en réalité jamais
partis. Une barque chargée de rochers symbolise bien l’impossibilité de flotter
sur le torrent de notre existence ; nous souhaitons partir hors de
nous-mêmes, mais nous sommes lestés par les bagages gravides de notre
cheminement. Le bombardement de notre vie par les aléas, les épreuves, les
désillusions, les trahisons, empêche notre migration et nous assigne à résider
en nous-mêmes.
L’ensemble de l’œuvre de Didier Mahieu, et pas seulement son
œuvre peint, parle de cette difficulté à circonscrire, à identifier, à
stabiliser ; elle est donc, décidément, marquée au sceau de l’impermanence,
du mouvant, de l’itinérant.
Cette peinture fait également citation de la grande tradition
de peinture occidentale, de Van Dijck à Antonio Lopez Garcia, agrégeant les
enseignements du virement abstrait de Jackson Pollock à Tapies, de l’arte
povera, du conceptuel et du surréalisme. Il est donc autorisé d’y voir une
cristallisation de talents divers, assemblant des pratiques souvent opposées,
rarement mixées en un même lieu de création, la toile, où la valeur de ce qui
se raconte vaut plus encore que la façon de le dire. Comment ne pas retrouver également
dans la peinture de Didier Mahieu des influences d’Anselm Kieffer ou de Andrew
Wyeth à travers non seulement le récit qui se retire mais aussi une vérité
descriptive du peintre figuratif qui rend compte de son environnement intime,
de ses tabous, de ses colères et de ses croyances ?
Le regard amoureux que notre artiste porte sur le monde et
sur la condition humaine en dit long sur l’humanisme à l’œuvre dans son
travail. Il est un humain qui partage les affres et les qualités de ses
semblables. Il souhaite par son œuvre apporter une explication à une part
confuse latente en nous, qu’il tente de déchiffrer non pas en cherchant la
bonne clé pour entrer dans la serrure, mais laissant la porte fermée, nous amenant
ainsi à imaginer ce qui se cache derrière.
J’ai lu l’ineffable palimpseste.
Constantin Chariot